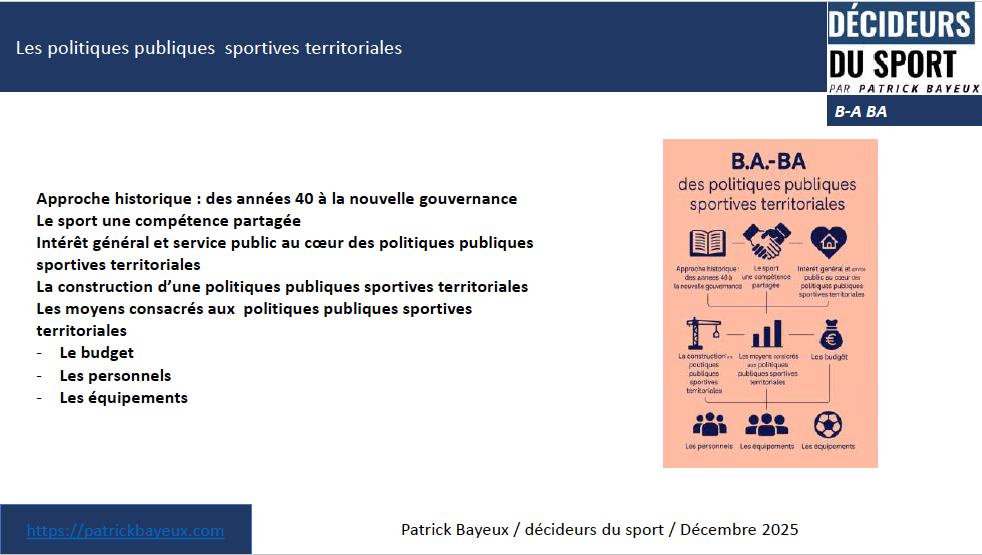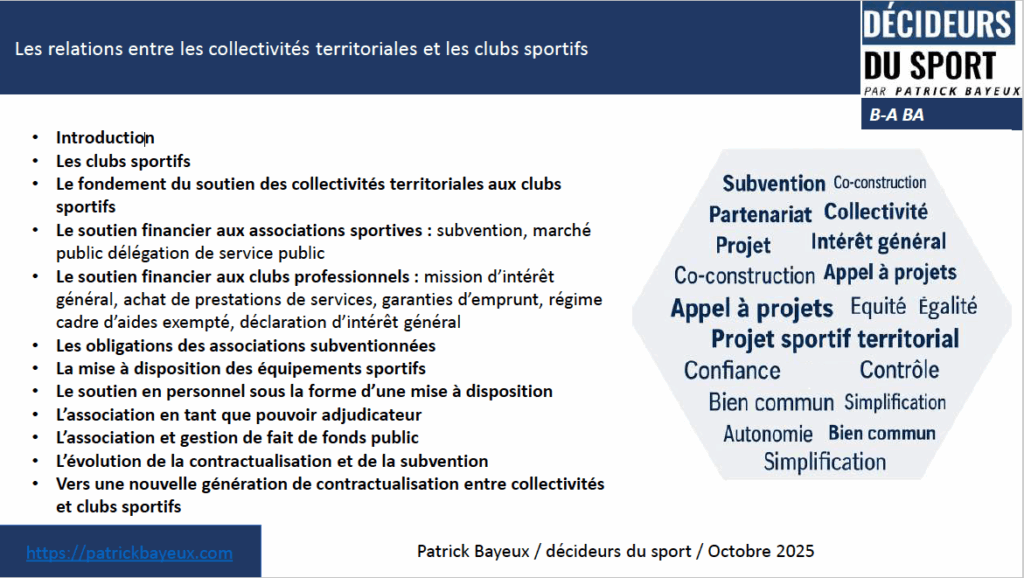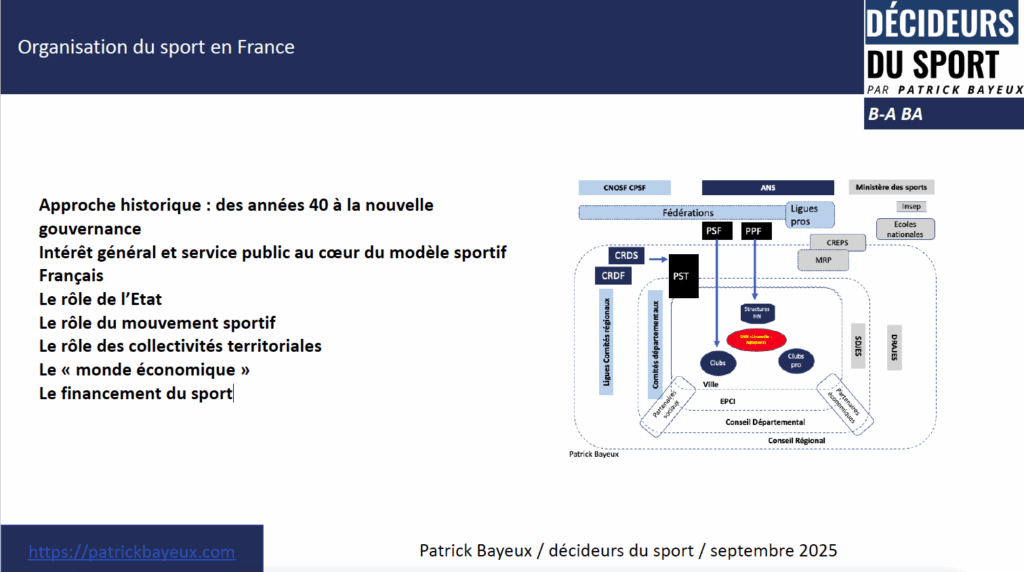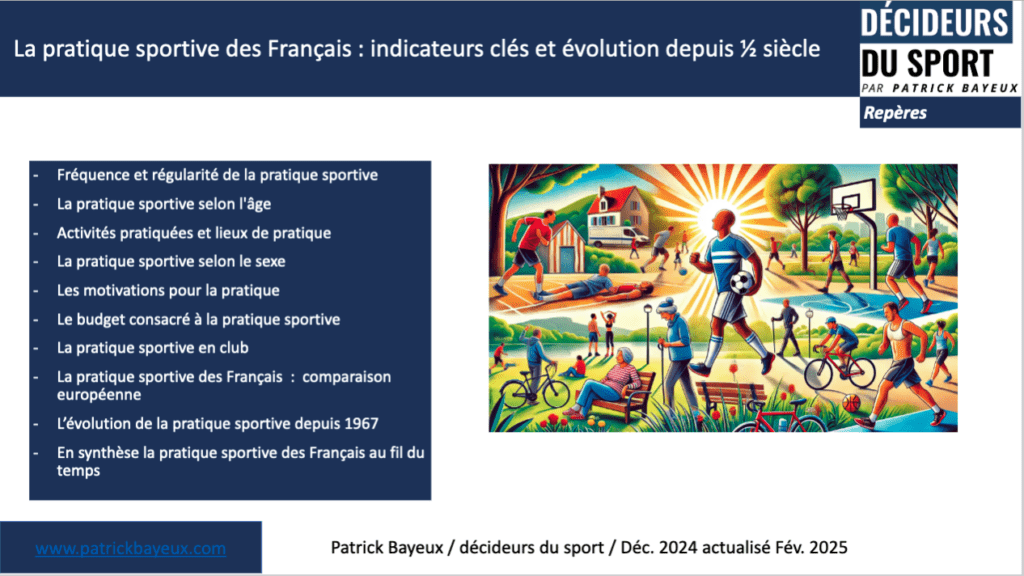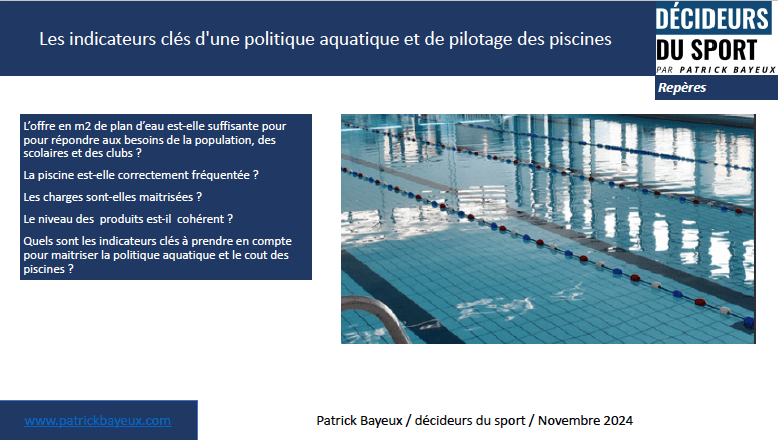Ultra-trail : ce que révèle la science sur ce sport extrême Mathilde Plard et Benoît Mauvieux
Pour la toute première fois, un ultra-trail scientifique a été organisé pour étudier les effets physiologiques et mentaux de l’effort prolongé. L’étude a porté sur 56 coureurs sur un parcours de 156 kilomètres. De quoi déconstruire quelques mythes et d’accumuler de nouvelles connaissances sur cette pratique extrême par Mathilde Plard Chercheuse CNRS – UMR ESO, Université d’Angers et Benoît Mauvieux Maître de Conférences en STAPS – Physiologie des Environnements Extrêmes, Université de Caen Normandie.
Les résultats de l’étude du trail de Clécy et les contributions académiques permettent d’identifier plusieurs recommandations :
- Individualiser l’entraînement : il n’existe pas de recette universelle, chaque coureur doit écouter son corps.
- Optimiser la récupération : la gestion du sommeil est un levier essentiel de performance et de bien-être.
- Accepter l’incertitude : la préparation mentale est une clé pour affronter l’inconnu et la fatigue extrême.
- Ne pas minimiser la période de récupération : on observe une forte élévation des marqueurs inflammatoire, une hyperglycémie et un sommeil de mauvaise qualité sur les nuits suivantes.
- Rester vigilant à l’automédicamentation : ne jamais courir sous anti-inflammatoire.
- Rester vigilant sur les troubles du comportement alimentaire et l’addiction à l’activité.
L’ultra-trail apparaît ainsi comme une école du vivant, entre prouesse athlétique et exploration humaine. La science permet aujourd’hui de mieux comprendre ce phénomène, tout en laissant place à la magie de l’expérience personnelle.