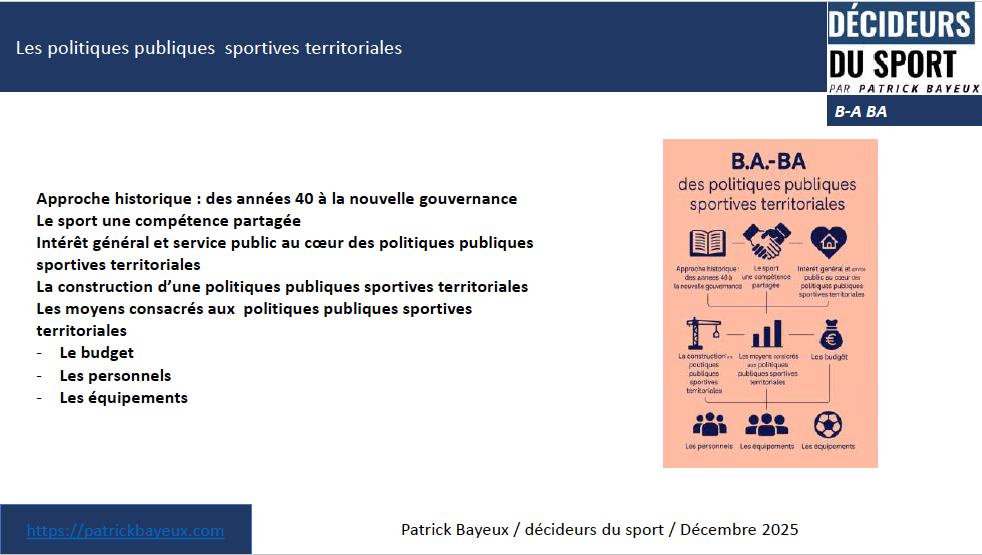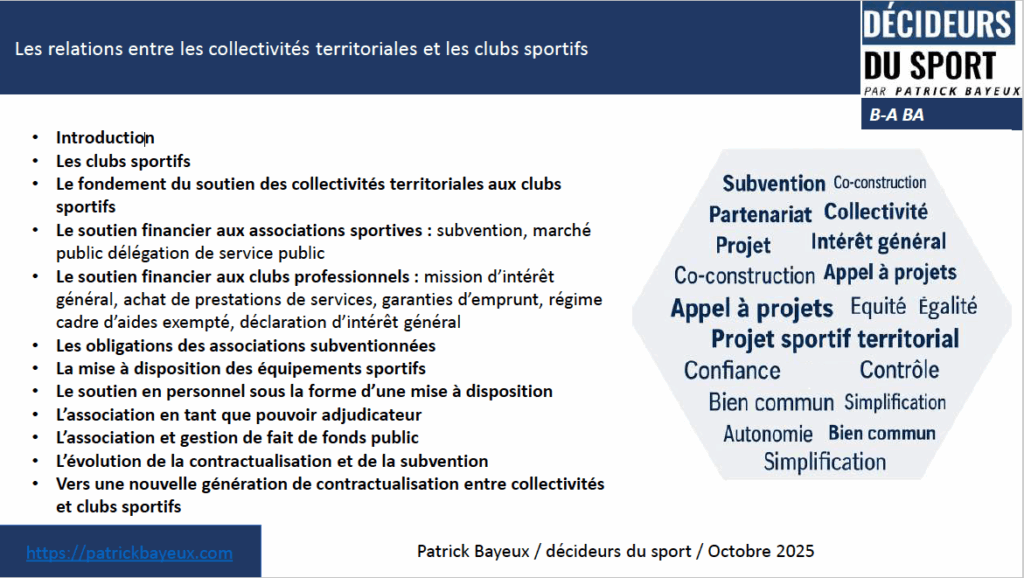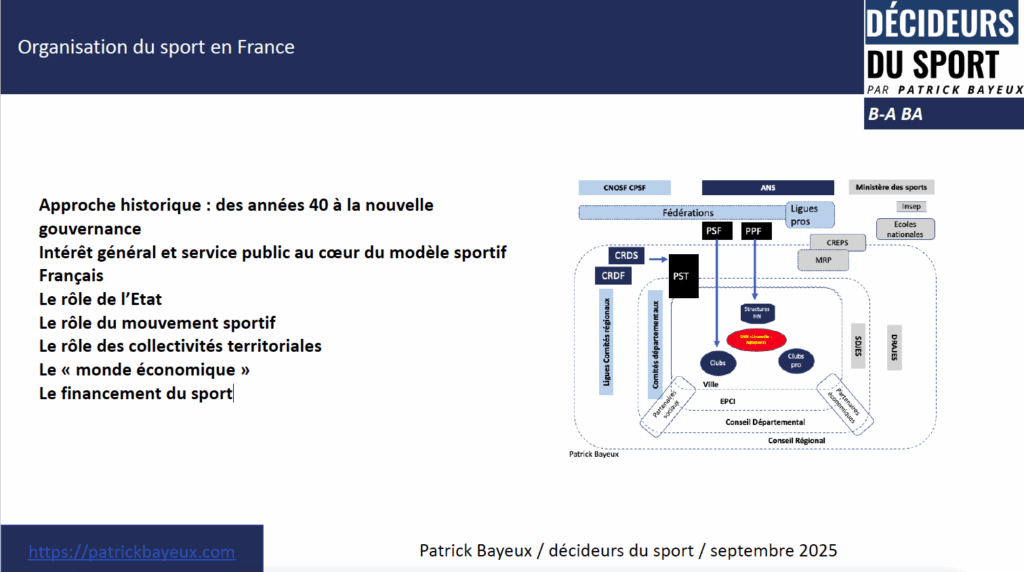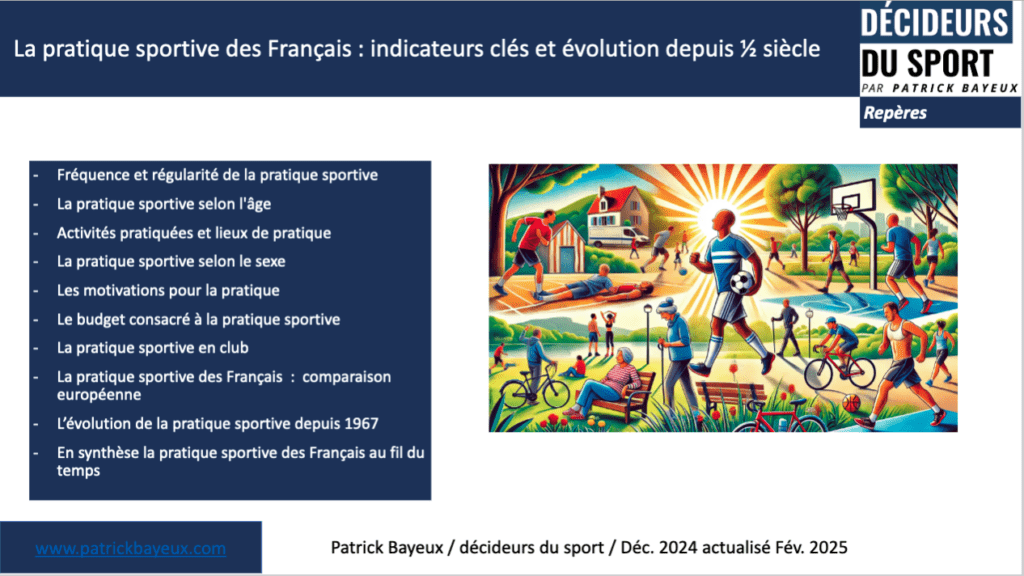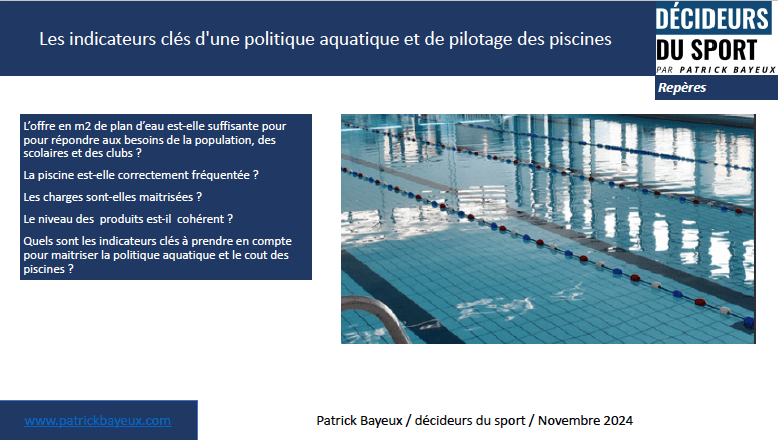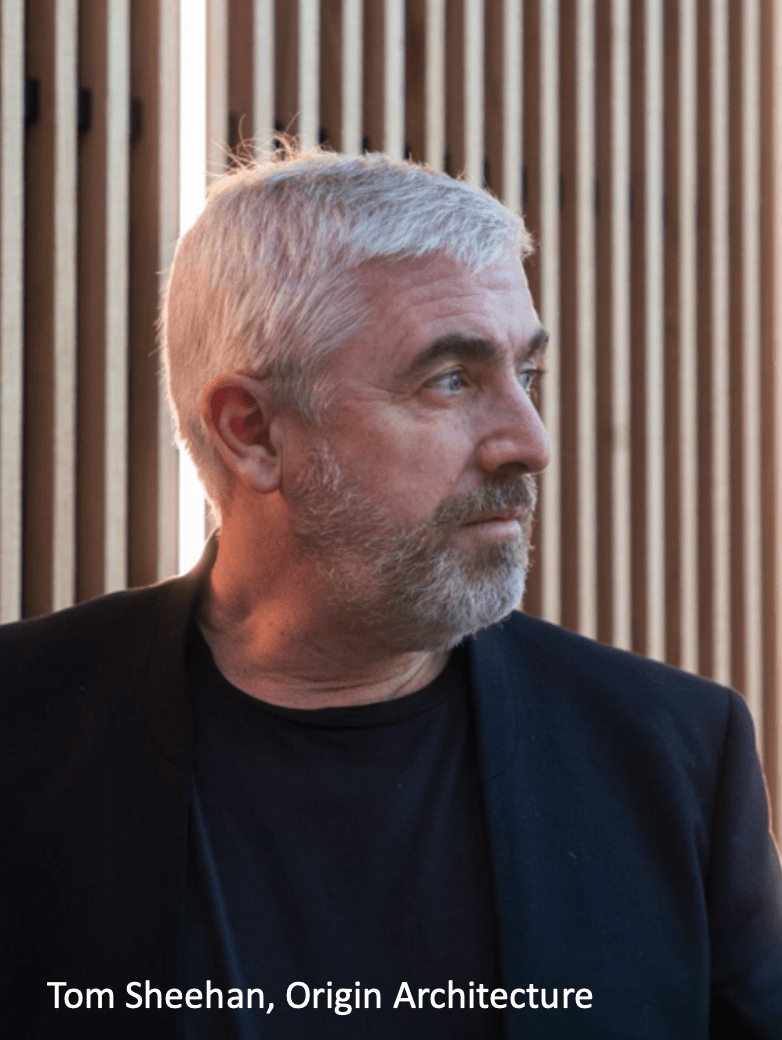Du Pain et des Jeux, pour un nouveau modèle économique des infrastructures sportives en France par Tom Sheehan, Origin Architecture
Face au vieillissement massif des équipements sportifs français, il est urgent de repenser un modèle économique obsolète, encore trop dépendant du financement public. Tom Shehan origin architecture défend une transition vers un modèle hybride public-privé, où les clubs deviendraient propriétaires de leurs infrastructures afin de garantir leur modernisation, leur rentabilité et leur durabilité. Sans réforme, la France risque de décrocher face à la concurrence internationale.
Le grand écart français
À quoi sert un stade vide ? Une salle de sport vétuste ? Un gymnase dont les rideaux ne s’ouvrent plus, sauf pour les heures d’EPS ? La France aime le sport, le soutient, l’encourage, l’enseigne — mais a-t-elle encore les moyens de ses ambitions ? Peut-elle continuer à financer seule un parc de plus de 300 000 équipements sportifs, dont la majorité est vieillissante, sous-exploitée et incapable de répondre aux standards contemporains de confort, de performance, de rentabilité ou même de sécurité ?
Depuis les années 1960, notre pays a bâti un réseau sans équivalent d’équipements sportifs publics, du plus modeste city-stade de quartier jusqu’aux enceintes nationales. Ce modèle a permis la démocratisation du sport, l’inclusion des territoires, et l’émergence de milliers de clubs amateurs et professionnels. Mais aujourd’hui, il craque de toutes parts. Plus de 60 % de ces équipements ont plus de 25 ans, et moins d’un tiers ont bénéficié de rénovations sérieuses. Les normes ont changé. Les usages ont évolué. Les besoins aussi.
Le paradoxe est cruel : jamais la pratique sportive n’a été autant valorisée dans le discours public, dans l’éducation, dans la santé, dans l’image que la France veut projeter à l’international. Et pourtant, jamais les outils de cette ambition — nos infrastructures — n’ont paru aussi obsolètes. Alors que d’autres pays investissent, innovent et professionnalisent leurs équipements sportifs, la France semble prisonnière d’un modèle hérité d’un autre siècle : centralisé, subventionné, figé.
Ce texte interroge ce modèle à bout de souffle, et propose d’en esquisser un autre — plus agile, plus hybride, plus durable. Le temps est venu d’ouvrir le débat sur la propriété, la gouvernance, la rentabilité et la vocation réelle de nos infrastructures sportives. Car derrière les murs fatigués de nos gymnases, c’est toute une vision du sport — et de la société — qu’il faut repenser.
Un modèle à bout de souffle
L’approche française repose sur un financement public massif qui, aujourd’hui, atteint ses limites. Les équipements vieillissants requièrent des investissements colossaux pour leur mise à niveau, alors que les collectivités locales sont de plus en plus contraintes budgétairement. Parallèlement, la compétition internationale impose de nouvelles exigences aux clubs, qui doivent non seulement moderniser leurs infrastructures, mais aussi les exploiter pour générer des revenus à long terme.
Le modèle actuel où les clubs sont locataires de leurs stades limite leur capacité à investir et à développer des infrastructures adaptées à leurs besoins et à leur public. En comparaison, en Angleterre, en Allemagne ou aux États-Unis, la propriété privée des stades permet aux clubs d’avoir une approche stratégique sur le long terme, d’optimiser leur exploitation commerciale et de maximiser leurs revenus hors jours de match.
Par ailleurs, l’effet des Jeux Olympiques et Paralympiques de l’an dernier a ravivé l’appétit des fédérations sportives françaises. L’engouement pour le sport a connu une croissance significative, mais l’insuffisance des infrastructures a été un frein majeur. Plus de 100 000 licences sportives potentielles ont dû être refusées faute de structures suffisantes pour accueillir de nouveaux pratiquants. Cette situation souligne l’urgence d’un modèle plus efficace et durable.
Un exemple à suivre : l’expérience du Parc des Princes
L’expérience récente du Parc des Princes illustre les défis du modèle public et les opportunités manquées d’une gestion privée. En tant qu’architecte ayant dirigé sa transformation entre 2012 et 2019, nous avons mené une rénovation majeure en concertation avec la Ville de Paris et le Paris Saint-Germain. Nous avons réussi à moderniser le stade sans perturber le calendrier sportif, augmentant à la fois le confort des spectateurs, celui des joueurs, et la rentabilité de l’infrastructure.
L’impact a été immédiat : les ventes de billets ont quadruplé, confirmant que des aménagements stratégiques pouvaient transformer un équipement vieillissant en un actif performatif. Cependant, l’incapacité du PSG à acquérir son stade limite aujourd’hui ses ambitions, illustrant le problème systémique de la gestion publique des infrastructures sportives en France.
Un contre-exemple : l’échec du Parc Olympique de Montréal
À l’opposé, le Parc Olympique de Montréal est l’exemple frappant de ce qu’un stade peut devenir lorsqu’il est figé dans son statut patrimonial. Transformé en monument historique, il est désormais gouverné par des considérations de préservation qui l’empêchent de s’adapter aux besoins contemporains. Les choix qui le concernent sont dictés par son concept original plutôt que par les exigences actuelles des utilisateurs potentiels, des événements sportifs et culturels mondiaux. Le résultat est un équipement sous-utilisé et coûteux, incapable de s’intégrer dans le marché du sport moderne. Cette situation illustre le destin que pourrait connaître le Parc des Princes s’il n’est pas géré dans une logique d’adaptation continue aux évolutions du sport et du divertissement.
J’ai eu l’honneur de faire partie des quatre experts chargés de conseiller les exploitants du Parc Olympique de Montréal. Cependant, en raison de divergences de vision sur l’avenir du site, j’ai fait le choix de quitter cette commission. Cette expérience a renforcé ma conviction : une gestion patrimoniale rigide empêche une infrastructure sportive de se réinventer et de rester compétitive dans un environnement en constante évolution.
Carrefour d’un nouveau modèle économique
Les équipements sportifs sont aujourd’hui à la croisée des chemins. Derrière la belle statistique des 318 000 équipements recensés en France se cache une réalité contrastée : la quasi-totalité des équipements à but non lucratif sont publics, tandis que ceux qui dégagent un chiffre d’affaires régulier sont très majoritairement privés. Le clivage n’est donc pas seulement juridique, il est structurel. Lorsque le sport est pratiqué librement ou à titre associatif, il repose sur la puissance publique. Lorsqu’il devient activité marchande (salles de fitness, golfs, événements), il bascule dans le privé.
Ce constat souligne une contradiction profonde. D’un côté, les associations sportives, les fédérations, les écoles et les collectivités locales bénéficient d’un accès gratuit ou subventionné aux équipements publics. Mais de l’autre, cette gratuité généralisée représente un coût énorme pour les budgets locaux, sans véritable stratégie de retour sur investissement. Les collectivités n’ont ni les outils réglementaires, ni la culture de la rentabilité permettant de tirer des revenus de leurs infrastructures. Les clubs, quant à eux, ne sont pas propriétaires de leurs enceintes, et ne peuvent donc ni en assurer l’exploitation commerciale, ni emprunter pour les moderniser. Ils restent dépendants de subventions aléatoires, incapables de bâtir une vision à long terme.
À ce jour, seuls deux clubs professionnels de football sont propriétaires de leur stade : l’AJ Auxerre avec l’Abbé Deschamps 1918 (héritage historique), et l’Olympique Lyonnais avec le Groupama Stadium 2016 (projet entrepreneurial exemplaire). Racing 92, avec Paris La Défense Arena, est dans une situation de contrôle partiel, mais sur un montage juridico-financier complexe. Tous les autres clubs — toutes disciplines confondues — évoluent dans des enceintes qu’ils n’exploitent pas pleinement. Et cela malgré les enjeux économiques, sociaux et médiatiques considérables que représente le sport professionnel.
Comment expliquer ce paradoxe français ? Il tient à la fois à des blocages politiques (réticence à vendre le patrimoine public), à des rigidités administratives (réglementations sur le domaine public), à une culture associative dominante (loi de 1901), et à une frilosité des acteurs bancaires à accompagner des projets portés par des clubs considérés comme financièrement fragiles. Le résultat : une immobilité systémique, dans un monde où le sport évolue à grande vitesse.
En parallèle, l’industrie du fitness, en très forte croissance depuis deux décennies, a totalement échappé au modèle public. Avec plus de 5 400 établissements en France — majoritairement privés —, elle a su s’adapter aux logiques de marché, créer des offres segmentées, investir dans des équipements modernes, et attirer une clientèle large. Là où le public peine à financer l’entretien d’un gymnase, le privé multiplie les ouvertures de salles connectées, flexibles, rentables.
Il est peut-être temps d’appliquer au sport collectif professionnel une réflexion similaire à celle qui a permis au fitness de s’émanciper. Pas pour remplacer l’intérêt général par le profit, mais pour sortir d’une dépendance malsaine aux subventions, en responsabilisant les clubs et en libérant leur potentiel d’innovation.
Le principe de « propriétaire-utilisateur » (ou actionnaire significatif) est un modèle envisageable. La France a manqué l’occasion de poursuivre cette voie lors du récent renouvellement du contrat d’exploitation et de propriété du Stade de France. Le projet porté par le collectif « SDF, notre bien commun » proposait un montage inédit : faire de la FFF et de la FFR, ainsi que de l’État et du département de la Seine-Saint-Denis, des copropriétaires. Ce modèle rappelle le schéma des partenariats public-privé (PPP), autrefois en vogue, mais avec une différence majeure : au lieu de placer un entrepreneur du BTP en position dominante, on place au cœur du dispositif les usagers, les parties prenantes, les riverains. Cela garantit que les flux de revenus sont réinvestis au service de l’activité sportive elle-même, et non captés par des actionnaires éloignés des réalités du terrain. C’est une voie alternative, plus démocratique, plus durable, qui mérite d’être explorée à l’échelle nationale.
Ce carrefour d’un nouveau modèle économique appelle une réforme structurelle. Il ne s’agit plus seulement d’accompagner les clubs dans la rénovation de leurs équipements, mais de leur donner la capacité d’en devenir propriétaires, exploitants et gestionnaires. De nouveaux montages doivent être imaginés : baux emphytéotiques, foncières sportives, partenariats d’investissement public-privé, garanties d’emprunt encadrées. La puissance publique doit jouer un rôle d’impulsion, non plus de substitution.
Il en va de la survie du sport professionnel en France. Sans réforme, le fossé se creusera entre les clubs français et ceux de pays qui, eux, ont su investir dans leurs infrastructures comme de véritables actifs stratégiques. Le stade, la salle, le campus d’entraînement ne sont plus des coquilles vides ou des charges fixes : ce sont les piliers d’un modèle économique à réinventer.
Vers un modèle hybride privé-public
Il est peut-être temps d’explorer un modèle hybride où les clubs deviennent pleinement acteurs de leurs infrastructures. La propriété et la gestion privée des équipements permettraient d’assurer leur entretien, leur modernisation et leur adaptation aux besoins du sport et du marché, tout en soulageant les finances publiques.
A lire
L’État et les collectivités doivent accompagner cette transition en facilitant l’accès à la propriété pour les clubs et en mettant en place des cadres réglementaires souples favorisant l’investissement privé. Cela implique de repenser les modèles de financement, les cadres de concession et les règles d’occupation du domaine public pour permettre aux clubs d’exploiter pleinement leur potentiel économique.
La transition vers un modèle privé-public ne signifie pas un abandon du service public du sport, mais une responsabilisation accrue des clubs dans la gestion de leurs infrastructures. La France ne peut plus se permettre d’entretenir seule un parc vieillissant de 300 000 équipements. Il est temps d’arrêter « le pain et les jeux » et de construire un modèle plus durable et efficace pour l’avenir du sport français.
Tom Sheehan, Origin Architecture